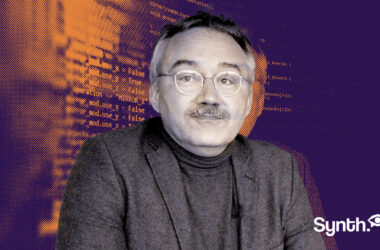EN UN COUP D’OEIL
- Une Europe dépendante : L’infrastructure numérique européenne est majoritairement contrôlée par des entreprises étrangères, ce qui la place en situation de subordination technologique.
- Vers un numérique public : Le rapport ” Reclaiming digital sovereignty” propose une “stack” numérique démocratique, écologique et orientée vers les biens communs.
- Nouvel internationalisme digital : Un mouvement des non-alignés numériques pourrait unir Europe, Sud global et société civile contre l’hégémonie sino-américaine.
Edemilson Paraná, professeur associé en sciences sociales à l'université de technologie de Lappeenranta (LUT) en finlande, spécialiste en économie politique de la transformation numérique, revient sur le rapport publié en décembre dernier intitulé "Reclaiming digital sovereignty" 1. Un rapport co-écrit avec Cédric Durand, Cécilia Rikap, Paolo Gerbaudo et Paris Marx qui explore des pistes concrètes pour mettre en œuvre la souveraineté numérique européenne.
Gerald Holubowicz : Comment ce rapport sur la souveraineté numérique européenne a vu le jour ?
Edemilson Paraná : L’idée de ce document a émergé suite à notre mobilisation lors des tensions entre Elon Musk et le Brésil concernant X (anciennement Twitter). Un juge de la Cour suprême brésilienne avait alors ordonné la suppression de certains profils diffusant de la désinformation liée à la tentative de coup d’État associée aux partisans de Bolsonaro. Elon Musk a refusé d’obtempérer, déclarant qu’il ne suivrait pas cet ordre. La situation a dégénéré au point où X a été bloqué dans le pays pendant environ une semaine. Finalement, Musk s’est conformé aux exigences légales et X a été rétabli.
Face à cette situation, nous avons rassemblé plusieurs intellectuels, décideurs politiques et experts pour rédiger une lettre ouverte soutenant la souveraineté numérique du Brésil contre les attaques d’Elon Musk. À notre grande surprise, de nombreux collègues éminents ont rejoint notre initiative, notamment Thomas Piketty, Joseph Stiglitz (lauréat du prix Nobel), Mariana Mazzucato et bien d’autres.
Suite à cette première mobilisation, avec ma collègue Cécilia Rikap, Cédric Durand, Paolo Gerbaudo et Paris Marx nous avons décidé d’aller plus loin en formulant des propositions concrètes pour faire avancer le débat public dans une direction différente. Nous ne voulions pas seulement adopter une posture défensive, mais aussi proposer des idées constructives autour desquelles nous pourrions nous mobiliser.
Gerald Holubowicz : Dans ce rapport, vous décrivez l’Europe comme subissant une forme de “retard numérique”, comparant sa dépendance aux géants technologiques à celle qu’ont connue les pays autrefois qualifiés de “périphériques”. Selon vous, quels sont les indicateurs les plus critiques de cette perte de souveraineté numérique en Europe, et ce phénomène est-il uniquement européen ou s’observe-t-il à l’échelle mondiale ?
Edemilson Paraná : Le fait que, fondamentalement, l’Europe ne contrôle pas les infrastructures critiques nécessaires à toute activité numérique est pour moi l’un des principaux indicateurs de cette perte de souveraineté. Pour vous donner quelques exemples concrets, 70% du marché mondial du cloud est contrôlé par seulement trois entreprises : Amazon, Microsoft et Google. La moitié des câbles sous-marins mondiaux sont également détenus par ces géants technologiques américains. Ces infrastructures de communication sont absolument critiques. À l’heure actuelle, elles sont presque entièrement contrôlées par des entreprises étrangères qui ne sont pas soumises à la législation européenne.
Il existe très peu de fournisseurs européens indépendants capables d’offrir ces services essentiels, ce qui conduit évidement à une dépendance matérielle vis-à-vis de ces acteurs, de leurs services et de leurs technologies. Aujourd’hui, l’Europe n’a pratiquement pas la capacité de traiter ses propres données sans dépendre d’entreprises américaines ou chinoises.
L’Europe ne contrôle pas les infrastructures les plus critiques qui sont nécessaires pour entreprendre tout type d’activité numérique.
Cette situation correspond exactement à ce qu’on observe dans les pays qui n’ont aucun contrôle sur les infrastructures de base nécessaires à la société numérique actuelle. Et pour répondre à votre question, il s’agit effectivement d’un phénomène mondial, mais l’Europe n’est pas habituée à se retrouver dans cette position. Pendant des décennies, l’Europe était du côté hégémonique, dominant. Mais la situation a changé, et dans l’économie numérique, l’Europe ne fait plus partie du pôle dominant.
C’est pourquoi, dans notre livre blanc, nous appelons à une forme d’internationalisme qui relierait l’Europe à l’Amérique latine, aux pays africains et asiatiques. Ces régions partagent désormais la même situation : une dépendance infrastructurelle, économique et technologique dans l’économie numérique. Je pense que l’Europe a encore du mal à accepter le fait qu’elle se trouve maintenant du côté des dépendants. En tant que Latino-Américain et Brésilien, c’est une réalité que nous connaissons depuis longtemps, et nous luttons contre ces problèmes d’autonomie et de souveraineté technologiques depuis des années.
L’Europe est maintenant invitée à rejoindre le club et à participer aux discussions sur la façon de transformer le paysage numérique vers un développement technologique et un ordre économique plus démocratiques, inclusifs, dirigés par le public et participatifs.
Gerald Holubowicz : Vous parlez beaucoup de la “stack numérique” qui occupe une place centrale dans votre analyse. Pouvez-vous nous expliquer ce concept et nous dire ce qui est véritablement en jeu ici ?
Edemilson Paraná : La première étape pour se libérer de cette situation de dépendance, c’est de penser de manière systémique. Il est crucial de connecter les points et de comprendre comment ces problèmes sont interconnectés, particulièrement lorsqu’il s’agit de technologies infrastructurelles comme les technologies numériques qui gouvernent nos vies aujourd’hui.
Au lieu de considérer ces technologies comme des éléments isolés – un moteur de recherche par-ci, une application ou une plateforme par-là – nous devons les comprendre comme une formation complexe composée de nombreuses couches différentes qui, ensemble, constituent notre économie numérique actuelle. C’est ce que nous essayons de faire avec ce document.
Il ne suffit pas de discuter de technologies particulières et de la façon de devenir compétitif dans tel ou tel domaine. Nous devons penser, en système, à la façon dont le secteur public, le secteur privé, la société civile et toutes les autres dimensions nécessaires peuvent créer une économie numérique qui nous sorte de cette situation de dépendance structurelle, technologique et économique.
Les effets de réseau et d’échelle jouent un rôle majeur ici. Dans certains marchés traditionnels, nous pouvons compter sur la concurrence pour maintenir un certain équilibre. Mais avec ces technologies, ce n’est plus le cas. Le vainqueur rafle tout. Et ce n’est plus vraiment une situation de marché idéal. C’est là qu’une combinaison d’approches doit entrer en jeu. La régulation est nécessaire, mais pas suffisante – et c’est ce que nous disons dans ce document.
Nous appelons ça une “stack” parce qu’il s’agit d’un empilement de différents niveaux et couches qui créent cette infrastructure numérique que nous utilisons actuellement : des câbles sous-marins aux satellites, en passant par les logiciels, les données, les centres de données, et aussi les talents qui se combinent pour créer le type d’économie numérique que nous avons. Aujourd’hui, cette stack est contrôlée verticalement par les grandes entreprises technologiques, et c’est là le problème.
Ce problème n’affecte pas seulement l’économie ou l’innovation technologique, mais aussi les démocraties elles-mêmes et la qualité du débat public, l’environnement démocratique sain, comme nous pouvons le voir assez clairement aujourd’hui. Nous devons donc aborder cette question de manière systémique, en appelant à une compréhension intégrée du problème auquel nous sommes confrontés.
Gerald Holubowicz : Quelles pourraient être les premières étapes concrètes pour regagner le contrôle sur l’infrastructure numérique ?
Edemilson Paraná : Il existe plusieurs voies à suivre, qui sont à la fois très concrètes et directes, même si elles feront l’objet de luttes importantes.
La première consiste à promouvoir les biens communs numériques, les solutions open source et les configurations technologiques participatives. C’est une direction assez directe à suivre. Nous avons beaucoup de connaissances et de technologies accumulées jusqu’à présent, et c’est assez simple de miser sur ces solutions pour de nombreux services que nous utilisons déjà.
On dit parfois que l’Europe n’innove pas, mais ce n’est pas du tout le cas. Nous avons de solides universités et instituts publics qui produisent beaucoup de recherches et de connaissances.
D’ailleurs, si nous prêtons attention à ce qui se passe réellement, ces solutions sont déjà largement utilisées dans l’économie numérique au quotidien. Le problème est qu’elles ne sont pas contrôlées démocratiquement, ni publiquement, ni par la société civile elle-même. Elles sont contrôlées par ces grands acteurs qui utilisent cette infrastructure de connaissances publiques, ces biens communs en termes de données, de connaissances et d’informations.
On dit parfois que l’Europe n’innove pas, mais ce n’est pas du tout le cas. Nous avons de solides universités et instituts publics qui produisent beaucoup de recherches et de connaissances. Le problème c’est que ce ne sont pas les Européens, les Latino-Américains ou les Africains qui s’approprient les bénéfices de cette immense richesse de connaissances.
Il s’agit donc simplement de modifier légèrement les cadres institutionnels pour utiliser réellement – pour le bien commun – toutes ces connaissances, informations et interactions que nous avons déjà. Donc, première étape : soutenir et promouvoir fortement les solutions communes et open source.
Deuxièmement, développer une politique industrielle numérique qui combine différents acteurs et différents niveaux d’intervention pour favoriser le développement technologique par les marchés publics, en utilisant le pouvoir des marchés pour stimuler le développement technologique, comme nous l’avons vu dans de nombreux autres secteurs tout au long de l’histoire économique.
Si nous combinons politiques industrielles, régulation et mise en œuvre effective, et transformation institutionnelle pour nous approprier les connaissances que nous produisons déjà dans les instituts de recherche et les universités, nous pouvons réellement changer la donne.
Notre rapport essaie d’attirer l’attention sur le fait que nous avons déjà des ressources en place. Il s’agit de changer notre état d’esprit pour penser différemment cette dépendance. Bien sûr, cela nécessite beaucoup de volonté politique, de mobilisation et d’organisation, mais cela fait partie du débat public que nous essayons de mettre en avant : ouvrir l’imagination politique à ce
« possible ». La principale question ici concerne l’action politique et la volonté politique de faire advenir ce changement.
Gerald Holubowicz : Vous défendez également un “mouvement des non-alignés numériques”, un concept qui circule depuis au moins cinq ans, peut-être plus, pour contrer l’hégémonie sino-américaine. Quels pays seraient susceptibles de rejoindre en premier ce mouvement, et quels critères pourraient structurer cette alliance ? En quoi consisterait-elle concrètement ?
Edemilson Paraná : Comme je l’ai dit précédemment, l’Europe n’était pas habituée à se retrouver du côté dépendant ; elle était plutôt habituée à être du côté dominant et hégémonique de l’ordre mondial. Mais l’économie numérique change rapidement les positions, et je vois que l’Europe dispose de nombreuses capacités et opportunités pour agir fermement dans ce domaine.
Je vois tout à fait l’Europe rejoindre un mouvement de non-alignement. Et à vrai dire, la situation géopolitique actuelle la pousse dans cette direction. Je pense que les forces progressistes et démocratiques européennes devraient pousser dans cette direction, en s’alliant avec les pays d’Amérique latine et d’Afrique.
Il y a des secteurs technologiques en croissance et beaucoup de choses intéressantes qui se passent en Inde, au Brésil et ailleurs. Ces développements, combinés à la volonté politique en Europe et ailleurs, pourraient créer l’espace nécessaire à un véritable changement mondial.
Bien sûr, un mouvement de non-alignement numérique impliquerait non seulement des pays, mais aussi des ONG, des mouvements, des partis politiques, et la société civile dans son ensemble, dans une sorte de grande consultation pour changer l’état des choses dans l’économie numérique. Comme vous le savez, cette économie engendre de nombreux problèmes environnementaux, économiques, et des tensions politiques considérables.
Nous sommes bien au-delà du point où nous aurions dû dire “assez”, et je pense que nous pouvons agir. Si nous utilisons le poids des marchés comme celui du Brésil ou de l’Europe, qui sont parmi les plus grands marchés numériques de la planète, nous avons un réel pouvoir. Pourquoi Elon Musk, après tout ce qu’il a fait contre le Brésil, a-t-il dû se conformer à la fin ? Parce que le marché brésilien est un poids lourd mondial en ce qui concerne les utilisateurs de X.
Nous appelons à une forme d’internationalisme qui relierait l’Europe à l’Amérique latine, aux pays africains et asiatiques. Ces régions partagent désormais la même situation.
Nous avons donc un pouvoir – ces pays ont un pouvoir institutionnel sur les marchés, un pouvoir social pour agir sur cette réalité et peuvent ouvrir la voie à un type différent d’économie numérique qui ne soit dominée ni par la Chine ni par les États-Unis.
Gerald Holubowicz : Il y a certainement un rôle pour les citoyens dans ce type de gouvernance numérique. Comment pourraient-ils s’organiser contre cette domination technologique et résister au récit des grandes entreprises qui prétendent être les seules solutions possibles – un peu comme le fameux TINA (There Is No Alternative) ? Comment créer une situation où le public et les citoyens se rassemblent collectivement pour faire la différence ?
Edemilson Paraná : Notre rapport va exactement dans ce sens : remettre en question l’idée qu’il n’y a pas d’alternative en ce qui concerne l’économie numérique. Les problèmes dont nous discutons s’appliquent en grande partie à l’économie dans son ensemble, et cela a beaucoup à voir avec le manque général d’imagination politique dont nous souffrons après des décennies de credo néolibéral. Il est temps de dépasser cette phase.
Depuis 2008, nous vivons une période étrange où le néolibéralisme est contesté mais en même temps encore très puissant, ce qui crée des situations terribles, dont l’économie numérique est un excellent exemple. Mais d’un autre côté, nous avons déjà de nombreuses alternatives en action.
Depuis longtemps, des personnes développent des plateformes, des technologies et des solutions open source. Ils les testent et les promeuvent depuis des décennies. Nous avons acquis et accumulé de l’expérience sur ces questions. C’est une façon de promouvoir la transparence et l’accès public à la prise de décision numérique. Si certaines de ces infrastructures ont été capturées par les grandes entreprises, elles existent toujours. Nous avons une énorme quantité d’énergie et de ressources mondiales consacrées à ces initiatives open source, qui sont encore très dynamiques aujourd’hui.
Mais nous avons aussi d’autres développements, comme les coopératives numériques, les forums de délibération publique, et de nombreux mécanismes que nous pouvons mettre en place avec le soutien d’organisations de la société civile, de forces politiques et même de l’État. Nous pouvons faire avancer ces mécanismes de participation, comme les budgets participatifs pour définir les priorités d’investissement dans ces domaines.
Dans le rapport, nous proposons de nombreuses idées pour y parvenir : plateformes universelles, clouds publics, infrastructures publiques numériques qui ne sont pas contrôlées ou capturées par les grandes entreprises technologiques.
Le problème auquel nous sommes confrontés est de savoir comment connecter tout cela, comment le rassembler pour changer le paysage. Mais nous voyons aussi une certaine dynamique. Même si le paysage n’est pas idéal, il y a aussi beaucoup d’opportunités pour faire avancer cette cause. Il y a un besoin, il y a un cas pour une nouvelle économie numérique qui préoccupe non seulement les forces démocratiques et progressistes traditionnelles, mais aussi les pouvoirs établis dans différents endroits autres que les États-Unis et la Chine.
Le problème à surmonter est ce blocage du débat et de l’imagination politique autour de ces questions. C’est ce que nous essayons de faire avec ce document, mais il y a aussi de nombreuses autres initiatives incroyables et fantastiques qui émergent partout, et nous devrions les connecter et essayer de les développer à grande échelle.
Gerald Holubowicz : Il y a à mes yeux un paradoxe lorsque vous appelez au développement d’une infrastructure en Europe, comme des centres de données et des câbles. En France, par exemple, nous avons 35 sites où des centres de données devraient être implantés dans la prochaine décennie. Comment conciliez-vous cet effort de création d’infrastructure avec les limites de la pression écologique ? Il y a une forte tension sur l’exploitation des minéraux pour créer ces outils très concrets. Comment réconcilier ces deux efforts ?
Edemilson Paraná : Nous pensons que faire progresser une stack numérique orientée vers le public, à des fins publiques, participative, démocratique et écologiquement concernée est une façon très importante de faire face à ce paradoxe.
Prenons un exemple. La différence entre Deepseek et OpenAI. Le pari américain sur la “force brute” pour l’entraînement de l’IA nécessitait beaucoup de puissance de calcul et donc des ressources pour fabriquer les composants des data-centers, de l’eau pour les refroidir etc . Ce choix n’était pas seulement une question de nécessité technologique. C’était aussi une question de convenance pour ces entreprises.
Pourquoi ? Parce que lorsque vous pilotez principalement par la mise à l’échelle, c’est facile à planifier, facile à mettre en place des investissements, facile à comprendre et tout aussi facile de prévoir la croissance et donc les profits. Mais il existe des approches technologiques alternatives qui sont plus efficaces en termes de ressources, plus intelligentes en termes d’économie de ressources.
Pourquoi ne prenons-nous pas une voie différente ? Précisément parce que ce qui gouverne ces initiatives et ces développements, c’est la quête du profit . Mais si vous avez un contrepoids à cette logique, si vous développez des technologies orientées pour répondre aux besoins sociaux, financées par nos recherches, nos institutions publiques, gouvernées par des plateformes universelles, fonctionnant dans des infrastructures publiques numériques, vous aurez tendance à aller dans une direction moins dépendante de ces approches gourmandes en ressources.
Le problème à surmonter c’est ce blocage du débat et de l’imagination politique autour des questions de souveraineté numérique
Je ne dis pas que c’est la solution miracle, mais je souligne que d’autres façons de gouverner la technologie ouvriront aussi la voie à l’imagination de différents types de technologies. En ce qui concerne les données, avons-nous besoin toute de cette quantité ? Certainement pas.
Mais c’est au cœur du modèle économique de ces grandes entreprises qui dévorent la planète en suivant leur business plan. Nous n’avons pas besoin de suivre cette voie si nous avons des marchés publics qui définissent les priorités et disent : “Nous voulons ce type de technologie, elle sera développée par ce groupe d’universités et sera hébergée sur ce marché numérique public.” Bien sûr, si les grandes entreprises technologiques veulent y aller et offrir les mêmes services, d’accord. Mais l’infrastructure ne devrait pas être contrôlée par ces entreprises.
Lorsque vous développez ces infrastructures cloud, vous pouvez favoriser des solutions, parce qu’elles sont financées par des fonds publics, qui sont plus efficaces en termes de ressources. Nous pouvons décider en tant que société, démocratiquement, de privilégier certaines options qui dépendent moins du big data, qui nécessitent moins de puissance de calcul, et nous pouvons même décider que certains types d’IA ne devraient tout simplement pas être autorisés.
C’est une question de décision politique, et c’est ce qui a la possibilité de changer le cours des choses. Pendant des décennies, nous avons compté sur les marchés pour s’occuper du problème environnemental, et ces marchés nous ont gravement fait défaut. Et ici encore, nous les avons laissé s’occuper des grandes entreprises technologiques et de l’économie numérique. Aujourd’hui, nous en voyons les résultats.
Avec cet exceptionnalisme numérique, les lois antitrust et les lois sur la concurrence et les monopoles que nous avons ne s’appliquent tout simplement pas à l’économie numérique, parce que c’est immatériel, c’est de l’information, c’est la liberté d’expression – c’est d’ailleurs ce que les grandes entreprises technologiques essaient à nouveau de nous imposer comme discours.
En connectant à nouveau les coopératives, l’open source, les biens communs numériques, l’infrastructure publique, la régulation, la politique industrielle verte dans ce domaine, il y a un potentiel énorme de changement si nous combinons tous ces instruments que nous avons à notre disposition.
 Soutenez Synth
Soutenez Synth
CET ARTICLE EST DISPONIBLE POUR TOUTES ET TOUS
Face à la domination des GAFAM et de leurs algorithmes opaques, nous vous aidons à reprendre la main sur les récits technologiques qui façonnent notre quotidien.
En soutenant Synth, vous co-construisez une voix forte, libre et indépendante.
Vous pouvez faire un don à partir de 1€
Contribuez dès aujourd’hui avec un don défiscalisé à 66 %.
Chaque euro compte, et un engagement mensuel multiplie l’impact.
- Reclaiming digital sovereignty: A roadmap to build a digital stack for people and the planet. Cécilia Rikap, Cédric Durand, Edemilson Paranà, Paulo Gerbaudo, Paris Marx, 2025 ↩︎