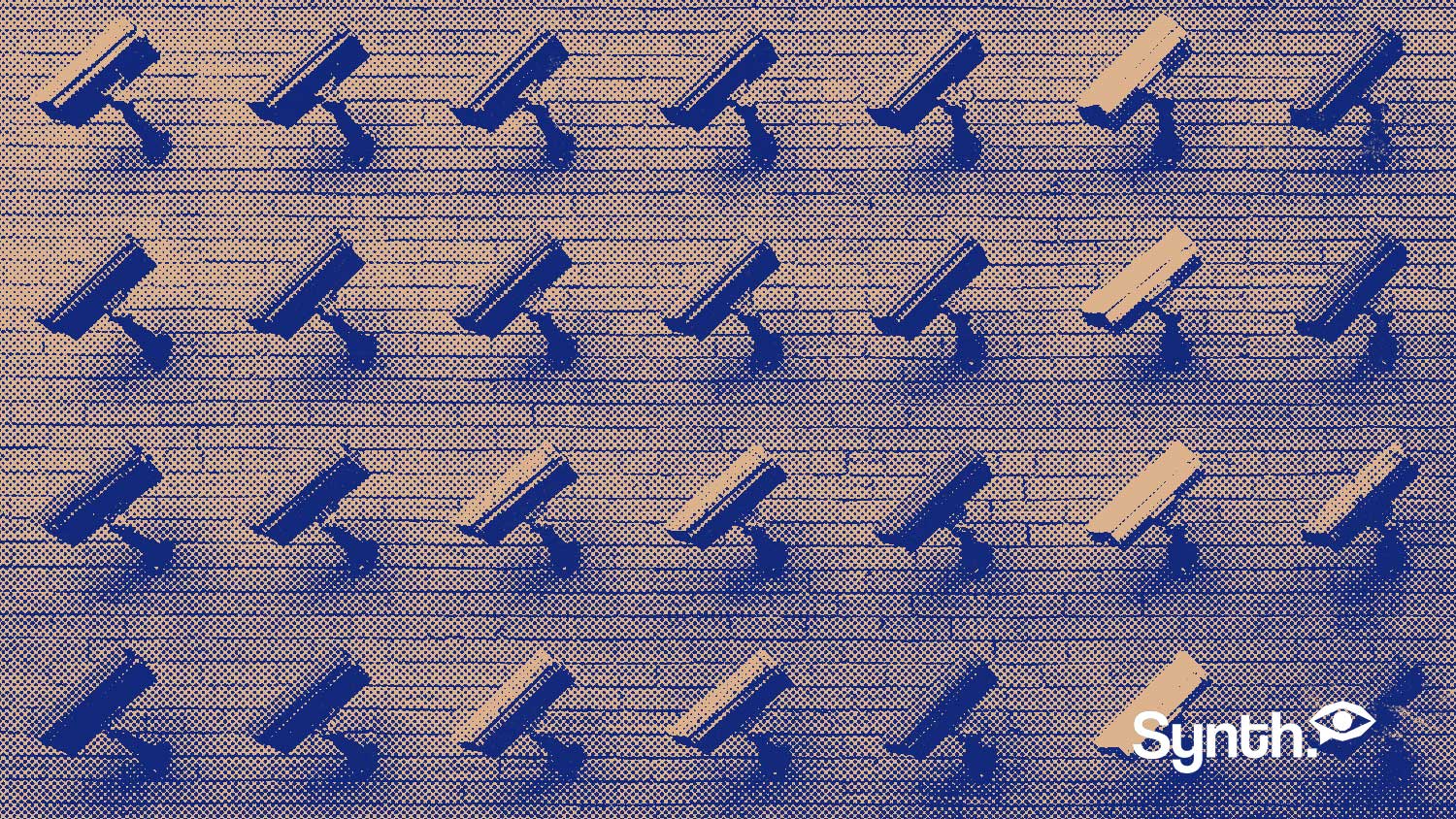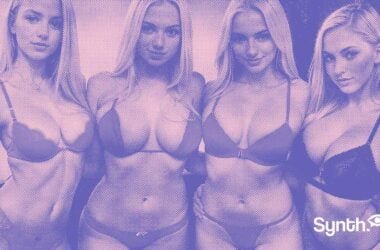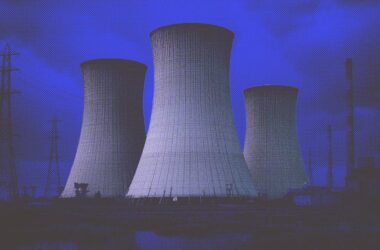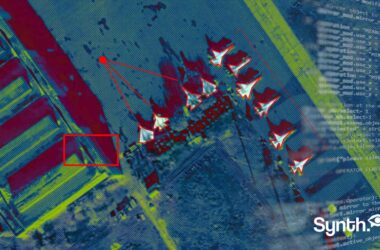EN UN COUP D’OEIL
- Une évaluation précipitée : Le comité d’évaluation, monté à la hâte, peine à établir des conclusions rigoureuses sur l’utilité réelle de la vidéosurveillance algorithmique.
- Pression politique et industrielle : Des intérêts financiers et des attentes gouvernementales biaisent le débat, favorisant la pérennisation sans preuves solides d’efficacité.
- Un débat stagnant : Depuis 20 ans, l’illusion technologique détourne des réflexions plus complexes sur la prévention et la sécurité publique.
Forces de l’ordre et réseaux de transport ont expérimenté, pendant les Jeux olympiques de Paris, plusieurs logiciels dopés à l’intelligence artificielle pour détecter des comportements dits
« anormaux ». L’expérimentation s’adosse à une évaluation, gérée par un comité nommé un mois avant le début des Jeux. Le gouvernement, peut-être tenté par la généralisation de ces outils, suivra-t-il l’avis du rapport publié en fin d’année, qu’importe les résultats ?
C’est l’histoire d’un œil sans paupière qui ne supporte pas son propre reflet. Le 2 octobre, un article de France info 1 a laissé penser que la vidéosurveillance algorithmique, expérimentée pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, pourrait être pérennisée par le gouvernement, avant même de connaître sa réelle utilité. À la suite de la publication de l’article, Matignon semble s’être souvenu de l’existence d’un comité d’évaluation, créé pour étudier les effets de l’utilisation de cet outil technologique. Finalement, il n’y aura pas de décision tant que le rapport de ce comité n’est pas publié, en fin d’année. Faux départ ou maladresse, cet épisode illustre une difficulté, celle de l’évaluation de l’utilité de la vidéosurveillance sur la voie publique en France.
« Cette expérimentation se fera-t-elle pour rien, parce que le gouvernement voudrait coûte que coûte pérenniser son utilisation ? Ou bien il y aura une réelle démarche de loyauté et une éthique de l’évaluation ? », se demande Jérôme Durain, sénateur socialiste de Saône-et-Loire, membre du comité susmentionné. Pour l’auteur d’un rapport parlementaire sur la reconnaissance faciale 2, la vidéosurveillance dite intelligente n’a pas fait ses preuves pendant les Jeux : « C’est loin d’être opérationnel et nous avons peu de recul. La détection d’armes et les colis abandonnés, ça ne marche pas, la détection des feux n’a pas été utile. » Deux cas d’usage semblent par contre fonctionner, la détection de mouvement de foule et l’intrusion dans des espaces non autorisés.
« Nous n’étions pas en situation d’évaluer suffisamment bien le dispositif », juge Nadine Bellurot, sénatrice de l’Indre, elle aussi membre du comité d’évaluation. « Nous pouvons féliciter le travail des forces de l’ordre, la sécurité a été à son maximum pendant les Jeux. Mais cette sécurité renforcée réduit en partie l’intérêt de l’expérimentation », pointe-t-elle. L’élue du parti Les Républicains estime qu’il faudrait tester ces outils dans des situations du quotidien pour se faire une meilleure idée de leur utilité.
Un temps réduit pour mettre sur pied un protocole d’évaluation
Devant les arrêtés de nomination des membres du comité d’évaluation, Guillaume Gormand, auteur d’une évaluation de la vidéosurveillance 3 dans des communes de la métropole grenobloise, se déclare sceptique. Ces nominations interviennent le 22 juin 2024, soit un mois avant le début des Jeux olympiques. « Même moi, qui suis expert sur la question de l’évaluation des politiques publiques, j’aurais été incapable de produire un protocole dans un temps aussi restreint. » Il compare : « Pour une étude bien plus modeste dans son périmètre, imaginer le protocole nous a pris six semaines. » L’étude évoquée, réalisée sur quatre communes en zone gendarmerie de la métropole grenobloise, avait fait parler d’elle au moment de sa publication, en 2021. Elle concluait à une aide à la résolution d’enquête très limitée.
Le docteur en administration publique salue cependant la présence d’experts indépendants dans le comité. « Quelques chercheurs ont été mobilisés, et c’est une bonne chose. Mais, sauf erreur de ma part, il n’y a pas de spécialiste de l’évaluation des politiques publiques et pas de criminologue. Il y a des techniciens et des juristes. » Nous avons sollicité plusieurs d’entre eux, mais aucun n’a souhaité répondre à nos questions, tous tenus par la confidentialité avant la publication du rapport. Selon Guillaume Gormand, cette composition traduit un choix : celui de se poser la seule question de l’efficience et de la conformité au droit. « Au-delà de l’efficacité technologique, il faut se demander : quel intérêt a cet outil pour les forces de l’ordre dans leur mission de sécurité publique, par rapport à une surveillance humaine classique ? »
« L’évaluation est nécessairement désacralisante et démystificatrice. »
Selon lui, le temps politique et ses intérêts propres ne convergent pas avec celui de l’évaluation. « La rigueur d’une telle étude, c’est trois à quatre années de travail. Le problème des responsables publiques, c’est qu’ils veulent un résultat trois à quatre mois plus tard. » Surtout, les résultats ne sont pas tout le temps ceux espérés : « L’évaluation est nécessairement désacralisante et démystificatrice. »
Et dérangeante. À l’Assemblée nationale, en mars 2023, Gérald Darmanin cite l’étude, souvent brandie par les sceptiques de l’usage des caméras, mais pour la tordre à son avantage. Le ministre déclarait que l’étude, de l’aveu de son auteur, était « partielle » et, ajoutait à son tour qu’elle était partiale. Mais si elle était partielle, c’est parce que la rigueur scientifique commande justement la prudence et ne permet pas de tirer des conclusions à portées générales sur un terrain réduit. L’honnêteté et la curiosité intellectuelle aurait dû peut-être pousser le ministère à se lancer dans un vaste programme d’évaluation rigoureux.
Au contraire, en matière de vidéosurveillance, la rigueur n’est pas tout le temps récompensée. Médiacités-Lyon révélait dans un article de 2021 4 l’existence d’une thèse « enterrée » sous le règne de Gérard Collomb. Le doctorant auteur du document nuançait l’efficacité du réseaux de caméras de la capitale des Gaules et posait une question pertinente : et si les réelles raisons du déploiement des caméras n’étaient pas celle de l’efficacité, mais plutôt celle des économies de moyens humains sur le terrain ?
Les caméras contribue à la résolution d’enquête selon… l’opinion publique
Les intérêts financiers ne sont jamais bien loin. Il n’y a pas que le gouvernement ou les scientifiques qui se soucient d’apporter une réponse à cette question. Les défenseurs de cette filière industrielle aussi ne veulent pas être laissés de côté, et ont bien compris que définir les critères d’évaluation, c’est se ménager des réponses confortables. Après la publication de l’étude de Guillaume Gormand, les esprits s’étaient échauffés lors d’une réunion de travail du lobby de la vidéoprotection. Elisabeth Sellos-Cartel, cheffe du bureau de la vidéoprotection au sein de la direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes (DEPSA), était présente.
Devant les résultats de l’étude, elle avait alors demandé de faire remonter les chiffres d’activité des centres de supervision urbains partenaires de l’AN2V, pour démontrer l’afflux de réquisitions judiciaires reçues. « Nous n’avons pas mené ce travail complètement », répond l’experte de la vidéoprotection. La cadre de Beauveau oppose les résultats d’une étude du Cevipof 5, réalisée en juin 2024, avec un échantillon de 3 438 personnes représentatives de la population française. 76 % des personnes interrogées estiment que la vidéoprotection « permet de mieux assurer la sécurité de la voie publique et contribue à la résolution des enquêtes ».
Elisabeth Sellos-Cartel ajoute : « Pourquoi je pense que c’est efficace ? Parce que le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui pensait retirer des caméras, non seulement il ne les a pas retirées, mais en plus, la métropole a mis en place un outil pour améliorer leur utilisation. » En l’occurrence, l’outil est une cartographie des caméras pour optimiser les réquisitions judiciaires des forces de l’ordre… Un projet mené par Guillaume Gormand, le même chercheur dont l’étude a pu être soupçonnée d’être partiale par l’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il y a 20 ans, Frédéric Ocqueteau, directeur de recherche au CESDIP, se penchait déjà sur ce défaut d’évaluation. Il démontrait que l’équipement en caméra pouvait être dans bien des cas « l’élément central d’une sécurité recherchée à court terme, qui dispense de réfléchir à la complexité de la prévention ». Vingt ans après, nous sommes toujours piégés dans ce débat qui tourne en rond, dominé par les mêmes rhétoriques et les mêmes approximations.
- Le gouvernement envisage de généraliser la vidéosurveillance algorithmique expérimentée pendant les JO, France Info, 2 octobre 2024 ↩︎
- La reconnaissance biométrique dans l’espace public : 30 propositions pour écarter le risque d’une société de surveillance, Rapport d’information n° 627 (2021-2022), déposé le 10 mai 2022, Sénat ↩︎
- Pour le chercheur Guillaume Gormand, “critiquer la vidéosurveillance, c’est s’attaquer à une religion”, aef info, 10 décembre 2021 ↩︎
- Vidéosurveillance à Lyon : la thèse critique enterrée sous Gérard Collomb, Médiapart, 3 novembre 2021 ↩︎
- Les technologies de sécurité innovantes : la perception positive des français, étude CEVIPOF et l’institut OpinionWay, Continuum Lab, septembre 2024 ↩︎