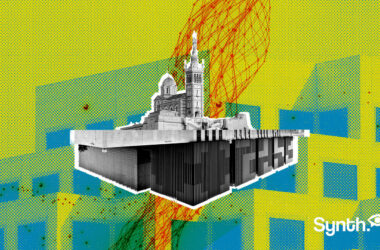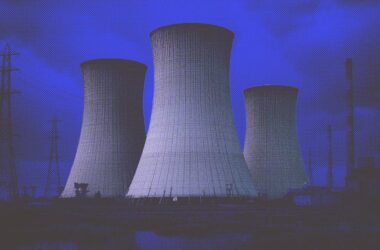EN UN COUP D’OEIL
- IA générative et explosion énergétique : Sa croissance dope la consommation mondiale des data centers, rendant les objectifs climatiques inatteignables.
- Retour des énergies fossiles : Faute de solutions bas-carbone rapides, l’industrie relance gaz et charbon pour soutenir ses infrastructures.
- L’efficacité en échec : Les gains techniques sont balayés par la croissance des usages, menant à une impasse écologique.
920 millions de tonnes de CO₂ en 2030 — près du double des émissions annuelles de la France. La consommation électrique mondiale des centres de données pourrait tripler d’ici 2035. Dans son dernier rapport 1 publié le 1er octobre, le Shift Project dresse un constat simple : le déploiement actuel de l’intelligence artificielle générative suit une trajectoire radicalement incompatible avec les objectifs climatiques. Pire, face au « mur énergétique », l’industrie réactive les énergies fossiles qu’elle prétend pourtant combattre.
La juxtaposition de l’actualité est terrible. D’un côté, les concertations préalables à l’implantation de Datacenters démarrent partout en France pour respecter le plan d’Emmanuel Macron de construire 35 infrastructures d’ici à 2030 2. Sora 2, le générateur de vidéos d’OpenAI, est lancé aux États-Unis et promet déjà les pires gabegies énergétiques 3 et le rapport du Shift Project « IA, données, calcul : quelles infrastructures dans un monde décarboné ? » alerte sur la dérive écologique de ces monstres de calcul. Dans le détail, les chiffres avancés par le Shiftproject font froid dans le dos, et la question ne se pose plus en termes d’optimisation technique, mais bien de rupture politique.
Une trajectoire d’émissions aux antipodes des objectifs climatiques
Les projections établies par le think tank créé par Jean Marc Jancovici en 2010 dessinent un scénario alarmant. La consommation électrique mondiale des centres de données — déjà établie à 530 TWh en 2023 — devrait atteindre 1 490 TWh en 2030, pour potentiellement tripler à 3 000 TWh en 2035. À titre de comparaison, la France consommait 450 TWh en 2024. Quant aux émissions de gaz à effet de serre directes de la filière, elles grimperaient de 250 MtCO₂e en 2020 à un pic oscillant entre 630 et 920 MtCO₂e d’ici 2030 — soit une multiplication par 2,5 en une décennie.
Une trajectoire qui fracasse tous les engagements climatiques noués jusque là. L’initiative SBTi — pourtant soutenue par l’industrie elle-même — recommande une réduction de 45 % des émissions du secteur entre 2020 et 2030. Or, le rythme actuel affiche une croissance annuelle composée de 9 % des émissions, malgré la décarbonation progressive du mix électrique. Et pas besoin de chercher le responsable très loin. L’IA générative porte le gros de la responsabilité dans cette accélération : sa part dans la consommation électrique des data centers devrait passer de 15 % en 2025 à 55 % en 2030, avec 94 % de cette consommation dédiée à la phase d’inférence — c’est-à-dire l’utilisation quotidienne par des centaines de millions d’utilisateurs.
Le rapport introduit une notion cruciale : celle du « plafond énergétique ». Même en imaginant un scénario optimiste où l’électricité serait massivement décarbonée à 25 gCO₂/kWh et la fabrication des équipements optimisée, la consommation annuelle des centres de données devrait se limiter à 950 TWh pour rester compatible avec l’objectif de réduction de 90 % des émissions d’ici 2050. La trajectoire actuelle de la filière franchirait ce seuil critique dans à peine deux ans, rendant l’atteinte des objectifs climatiques physiquement impossible sans une sérieuse remise en cause du modèle de croissance.
CET ARTICLE EST GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS
Engagez-vous avec nous, faites un don défiscalisé et faites vivre un média indépendant !
Le retour aux énergies fossiles
Face à ce « mur énergétique », la réponse des acteurs de la tech est conforme au climatoscepticisme du président américain. Aux États-Unis, où l’impossibilité de déployer suffisamment vite des capacités bas-carbone — les projets de réactivation de centrales nucléaires ou les solutions géothermiques n’étant pas attendues avant 2030 — se heurte à l’urgence commerciale, la solution adoptée repose sur le gaz fossile, à l’instar du datacenter xAI d’Elon Musk situé à Memphis, Tennessee. Au moins 85 centrales sont en développement dans le monde pour alimenter spécifiquement des centres de données. Meta prévoit à elle seule 2,3 GW de nouvelles capacités ; dans le sud-est des États-Unis, 20 GW de capacités au gaz sont planifiés, susceptibles de générer jusqu’à 80 MtCO₂e par an.
Le charbon lui-même connaît un sursis inattendu. L’entreprise First Energy a annulé la fermeture de deux centrales4 pour répondre à la demande des data centers, qui prévoit de les exploiter jusqu’en 2035-2040. Le cas de xAI à Memphis illustre également cette dérive énergétique. Pour alimenter son centre de données « Colossus », construit en 19 jours selon la communication d’Elon Musk, l’entreprise a déployé 15 vieilles turbines à gaz, sans même avoir notifié les autorités ni avoir mis en place de surveillance réglementaire 5. Chacune émet 11,51 tonnes de polluants particulièrement dangereux par an, un volume qui dépasse le plafond fixé par l’EPA. L’infrastructure est par ailleurs implantée à proximité de Boxtown, un quartier historiquement noir déjà accablé par une pollution industrielle chronique depuis de longues années dans le comté de Shelby qui affiche un taux de cancer quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Le greenwashing n’a donc pas de limites. Les géants de la tech qui prétendent résoudre le changement climatique grâce à l’IA s’assurent du fonctionnement d’infrastructures climaticides pour des décennies à venir, quel que soit le coût.
L’impasse de l’efficacité énergétique face à la croissance exponentielle
L’histoire récente du secteur montre clairement que le mythe du « plafond » lié aux gains d’efficacité ne tient plus. Contrairement aux estimations optimistes des années 2010-2020, la consommation électrique des centres de données n’a jamais plafonné. Les progrès techniques en termes d’optimisation de la consommation se trouvent systématiquement dépassés par la croissance exponentielle des usages. Un phénomène que les économistes nomment « effet rebond » 6. Cette dynamique résulte de trois facteurs qui se renforcent mutuellement : l’adoption massive encouragée par l’imposition de l’IA dans les interfaces numériques, la complexification des modèles dont la taille a été multipliée par 10 000 entre 2018 et 2023, et l’expansion continue des infrastructures physiques, les fameux datacenters7.
Le cas DeepSeek, modèle chinois qui a été présenté un peu rapidement par les médias mainstream comme une « révolution énergétique », illustre parfaitement ce piège. Si ses coûts d’entraînement ont effectivement diminué grâce à des techniques d’optimisation, son architecture de raisonnement génère des réponses beaucoup plus longues et complexes nécessitant davantage de puissance computationnelle. Résultat : lors de tests indépendants menés par le MIT Technology Review, le modèle a consommé 87 % d’énergie supplémentaire à l’usage par rapport aux modèles traditionnels 8.
Le rapport du Shift Project formule 20 recommandations structurées autour de quatre axes. La mesure et la transparence, l’optimisation, la réorganisation vers la sobriété et la formation. Très bien, mais au-delà des leviers techniques, le rapport propose d’adopter des mesures plus radicales, comme l’établissement de budgets carbone contraignants, l’évaluation systématique de la pertinence de chaque service d’IA via une analyse du cycle de vie complet, et l’abandon pur et simple des déploiements incompatibles avec les trajectoires de décarbonation. Sans pilotage politique fort et une réorientation des modèles d’affaires, l’emballement actuel aggravera la crise climatique, déstabilisera les systèmes énergétiques et compromettra la transition bas-carbone. Reste une question : dans quelle mesure nos sociétés accepteront-elles de soumettre le déploiement de l’IA aux contraintes physiques de la planète plutôt que de laisser l’industrie tech façonner notre avenir énergétique selon ses seuls impératifs commerciaux ?
- Intelligence artificielle, données, calculs : quelles infrastructures dans un monde décarboné ?, Shift Project, 1er octobre 2025 ↩︎
- Les data centers chers à Macron électrisent EDF, Le Canard Enchainé, 5 juillet 2025 ↩︎
- OpenAI’s newly launched Sora 2 makes AI’s environmental impact impossible to ignore, The Conversation, 9 octobre 2025 ↩︎
- FirstEnergy won’t exit coal by 2030, Factor This, 2024 ↩︎
- Le datacenter xAI d’Elon Musk viole la loi en multipliant les turbines à gaz sans permis, DCMag, 14 avril 2025 ↩︎
- Paradoxe de Jevons et effet rebond, Bon Pote, 21 avril 2024 ↩︎
- Zuckerberg says Meta will build data center the size of Manhattan in latest AI push, The Guardian, 16 juillet 2025 ↩︎
- DeepSeek might not be such good news for energy after all, MIT Review, 31 janvier 2025 ↩︎
 Soutenez Synth
Soutenez Synth
CET ARTICLE EST DISPONIBLE POUR TOUTES ET TOUS
Face à la domination des GAFAM et de leurs algorithmes opaques, nous vous aidons à reprendre la main sur les récits technologiques qui façonnent notre quotidien.
En soutenant Synth, vous co-construisez une voix forte, libre et indépendante.
Vous pouvez faire un don à partir de 1€
Contribuez dès aujourd’hui avec un don défiscalisé à 66 %.
Chaque euro compte, et un engagement mensuel multiplie l’impact.